8. Le travail, le grand intégrateur ?
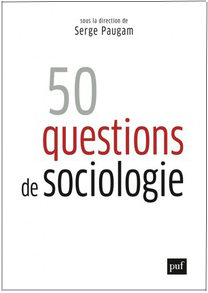
Patricia Vendramin, « 8. Le travail, le grand intégrateur ? », in Paugam Serge (dir.), 50 questions de sociologie, Paris, Presses universitaires de France, 2020, p. 93.
Lorsqu’Émile Durkheim (1893) cherche à comprendre les fondements du lien social dans les sociétés modernes, il met en évidence le processus de spécialisation et de complémentarité dans la division du travail social qui sera le fondement de la solidarité sociale et de l’intégration de la société. Ce processus de spécialisation, qui dépasse le monde économique, conduit à davantage de collaboration entre les individus et accentue leur complémentarité. Cette interdépendance entre les individus produit la solidarité sociale nécessaire à l’intégration de la société. Participer à l’activité productive donne ainsi une position sociale, une place et une fonction articulées et complémentaires à celles des autres membres de la société. Cette participation inclut l’individu dans un vaste système de solidarité et lui donne un sentiment d’utilité sociale. Aujourd’hui, la persistance d’un chômage de masse, les atteintes à la qualité du travail, les menaces qui pèsent sur l’emploi en lien avec la numérisation de l’économie, l’hypothèse d’une relativisation du travail en tant que valeur, ou encore le retour en force de plaidoyers en faveur d’un revenu de base, sont-ils autant de signes qui témoignent d’une érosion de la fonction intégrative du travail ?
Travail et salariat au cœur de l’intégration sociale
L’idée que le travail est une activité à travers laquelle les êtres humains peuvent transformer le monde, le faire à leur image et trouver dans ce processus un des principaux moyens de participer à la vie sociale et d’exprimer leur personnalité est récente et éminemment moderne. Depuis l’Antiquité, le travail a peu à peu occupé une position de plus en plus centrale dans les sociétés. Dominique Méda (1995) développe la thèse du caractère historique du concept de travail selon laquelle notre concept moderne de travail est le résultat de plusieurs couches de signification qui se sont sédimentées au fil du temps. La première étape dans la construction de la notion de travail est celle des économistes du xviiie siècle qui définissent le travail comme un facteur de production procurant un revenu. Ce siècle a été le témoin du succès et de la formalisation de cette première signification, en particulier dans les travaux d’Adam Smith, après plusieurs siècles de préparation théorique au cours desquels le travail, jusque-là méprisé, a été reconnu comme ayant une valeur. Le travail est alors défini comme « ce qui crée de la richesse », notre actuel « facteur de production ». À cette époque, il continue néanmoins d’être considéré comme une punition, un sacrifice, une « désutilité » diraient les économistes. La deuxième période, au xixe siècle, pose le travail comme l’essence de l’homme, c’est-à-dire une activité humaine qui permet à l’homme de s’exprimer et de transformer le monde – en référence aux travaux d’Hegel et de Marx. Cette seconde signification est radicalement différente de la première. Le travail est considéré comme la liberté créatrice de l’homme, celle qui va lui permettre d’aménager le monde et de se transformer. Enfin, la troisième couche de signification est celle du xxe siècle quand le travail devient aussi un système de distribution de revenus, de droits et de protections. Il correspond au développement de la société salariale ; divers droits dérivés du travail sont mis en place pour protéger les travailleurs – droit du travail, de la protection sociale. Le travail devient également un emploi et il va être apprécié non seulement pour le revenu qu’il procure ou pour l’expression de soi qu’il permet, mais aussi pour les droits auxquels il donne accès. Ces trois significations ne se sont pas substituées l’une à l’autre, elles se sont superposées ; elles ont constitué le support des interprétations et des attentes des individus.
Mais le travail a longtemps été assimilé à une activité difficile. Les dimensions de l’accomplissement étaient réservées aux activités les plus proches de l’art, tandis que pour les autres types d’activités, le travail restera longtemps du côté du devoir et plus généralement du côté de la dimension « instrumentale », c’est-à-dire considéré comme un moyen au service d’autres fins. Le retournement qui voit la dimension à la fois instrumentale et doloriste du travail s’effacer au profit d’une autre dimension, plus liée à l’activité elle-même et à ses conséquences sur l’individu lui-même s’opère à deux moments : au niveau théorique, au xixe siècle siècle – exprimé chez Hegel et Marx – et dans les faits à partir de la seconde moitié du xxe siècle, lorsque, les conditions concrètes vont être réunies pour glisser d’un ethos du devoir à un ethos de l’épanouissement. Ce glissement sera porté, d’une part, par le développement de l’État social et de l’idée qu’il incombe à celui-ci de garantir aux citoyens le bien-être et, d’autre part, – et surtout –, par l’explosion des taux de croissance qui soudain rendront réalisable et accessible ce qui n’apparaissait jusqu’alors que comme une utopie : faire du travail-devoir un plaisir.
La norme d’emploi qui se construit à partir de ce moment prend la forme d’un compromis social global qui constitue un puissant facteur d’intégration des travailleurs à la société. Le travail donne une rémunération, un statut assorti de droits sociaux et une identité sociale. Il est le support à la citoyenneté sociale. Le sésame de l’intégration sociale est « l’emploi standard », qui a valeur de modèle car il donne accès à tous les droits dérivés du travail et la reconnaissance sociale. Ensuite, à partir des années 1970, le monde du travail va connaître de profonds bouleversements et l’intégration par le travail va prendre des formes plus ou moins inabouties. Occuper un emploi n’est plus a priori l’assurance d’une pleine intégration sociale. C’est ce que décrit Serge Paugam (2007) lorsqu’il distingue parmi les salariés quatre formes d’intégration selon, d’une part, la nature du travail, apportant ou pas la satisfaction au travailleur et, d’autre part, la relation d’emploi, assurant la sécurité ou pas. Le croisement de ces deux variables – satisfaction au travail et sécurité d’emploi – produit quatre formes d’intégration sociale, allant de la plus souhaitable – l’intégration assurée qui conjugue satisfaction au travail et sécurité d’emploi – à la plus fragile – l’intégration disqualifiante alliant insatisfaction dans le travail et insécurité dans l’emploi. Dans la même veine, Richard Sennett (2000) met la flexibilité au cœur de ses analyses lorsqu’il parle de « travail sans qualités ». Celle-ci n’est pas la réalité exclusive des travailleurs sans qualifications ; elle concerne, plus globalement, toutes les couches de salariés, jusqu’à l’élite professionnelle. Devenu depuis près d’un siècle espace de socialisation, le travail se fragmente en de multiples états provisoires et précaires. La thèse développée par R. Sennett est que le caractère éparse et fragmentaire des itinéraires individuels non seulement corrode l’identité de chacun, mais fait manifestement obstacle à la vie en société. Avec le concept de désaffiliation, Robert Castel (1995) montre comment l’incapacité du travail à assurer l’intégration sociale s’inscrit dans un processus qui conduit à la rupture des liens qui unissent l’individu à la société. Les situations marginales sont ainsi l’aboutissement d’un double processus de décrochage : par rapport au travail et par rapport à l’insertion relationnelle. Si l’intégration dans le travail peut être minimale et laborieuse en raison de la nature du travail et de l’emploi, l’absence d’emploi est la situation ultime qui prive l’individu des fondements de son intégration. De nombreux auteurs ont décrit les effets délétères du chômage, bien au-delà de la dimension économique (Schnapper, 1994). Ainsi, les jeunes NEETs (not in employment, education and training), c’est-à-dire les jeunes « ni dans l’emploi, ni dans l’éducation, ni dans la formation » n’ont plus de visibilité sociale ; ils disparaissent des statistiques et n’ont même pas d’existence administrative. Ils sont définis par une triple négation. Dans une société salariale qui s’effrite, où le travail échoue de plus en plus souvent à assurer son rôle d’intégrateur social, cela signifie-t-il qu’il cesse d’être perçu comme tel ? D’autres supports à l’intégration sociale se mettent-ils en place ?
Une centralité du travail réaffirmée en dépit d’annonces régulières de la fin du travail
De nombreuses voies ont avancé l’hypothèse d’une distanciation à l’égard de la valeur travail, en particulier parmi les jeunes, celui-ci aurait perdu de sa centralité et ne serait plus investi que pour la sécurité et les revenus qu’il procure. Dominique Méda et Patricia Vendramin (2013) ont analysé cette hypothèse de la distanciation dans le cadre d’une recherche européenne. Elles concluent que ce n’est pas tant l’opposition entre distanciation ou centralité qui permet de caractériser les tendances à l’œuvre en matière de rapport au travail mais le concept de polycentralité qui s’avère plus éclairant pour comprendre les équilibres qui s’opèrent dans les choix individuels. Le travail reste essentiel mais il n’est plus la composante unique de la construction identitaire et de l’équilibre existentiel ; la famille, les amis, les loisirs, la vie sociale, l’engagement militant, etc., font également partie de la construction de l’identité sociale. L’hégémonie de la valeur travail fait place à une conception polycentrique de l’existence. Ce type de rapport au travail est également celui dont Daniel Mercure et Mircea Vultur (2010) signalent le très fort déploiement au Québec. Ainsi, en dépit de conditions de travail fortement transformées et de l’augmentation de maux et d’insatisfactions liés au travail, l’importance de ce dernier est confirmée. Les grandes enquêtes internationales confirment cette perspective, ainsi dans les vagues successives de l’enquête EVS (European value survey) seule une minorité de personnes interrogées – moins de 20 % dans quasiment tous les pays – déclaraient en 2008, mais aussi en 1990 et en 1999, que le travail n’est « pas très important » ou « pas important du tout » dans leur vie. Le module « Work orientation » de l’enquête ISSP 2015 (International social science programme) débouche sur des résultats qui pointent également l’importance du travail.
À une centralité plutôt relative du travail et un effritement de la condition salariale s’ajoute un retour du débat sur la fin du travail, dans la foulée de certaines prévisions alarmistes en matière d’impacts de la numérisation sur l’emploi (Valenduc & Vendramin, 2019). Ce débat se renouvelle à la faveur d’une vague d’innovations dans les domaines des machines intelligentes et apprenantes, des algorithmes d’exploitation des données massives et du développement des plateformes en ligne. La question de la fin du travail n’est pas neuve. Faut-il rappeler que Marx considérait que le développement des forces productives, notamment le progrès technique, devait réduire au minimum le temps consacré au travail salarié et favoriser ainsi l’émancipation des travailleurs ? Que Keynes prédisait en 1930 que, cent ans plus tard, il suffirait de travailler quinze heures par semaine pour produire toutes les richesses nécessaires au bien-être ? Les écrits d’André Gorz, dès le début des années 1980, prévoyait une diminution drastique du travail hétéronome.
De nombreuses publications récentes, dont quelques best-sellers nord-américains, annoncent le remplacement prochain et inéluctable du travail humain par une nouvelle génération de machines apprenantes et de systèmes d’intelligence artificielle. Cette thèse n’est pas récente ; elle a été avancée vingt ans plus tôt par Jeremy Rifkin (1995) ; celui-ci ne prône cependant pas une société sans travail car il reconnaît que le travail est source d’identité et d’intégration. C’est pourquoi il envisage non seulement de réduire le temps de travail salarié mais aussi de développer, au bénéfice des travailleurs sans emploi, un tiers secteur non marchand, ni public ni privé, centré sur l’attention donnée aux autres – ce que nous appelons aujourd’hui le care – où les travailleurs bénéficieraient d’un revenu de substitution ou « salaire social ». Le point faible du raisonnement de J. Rifkin est que ses prévisions en matière d’emploi ont été largement démenties par les faits. Toutes ces prévisions alarmistes portent toutefois la marque d’un optimisme technologique assez naïf et font l’impasse sur les dimensions sociétales de la diffusion des innovations. De plus, elles révèlent une conception simpliste du travail. Celui-ci ne se réduit pas à un assemblage de tâches plus ou moins remplaçables par des machines intelligentes. Il est le fruit de choix organisationnels et de rapports de forces et reste en outre le vecteur-clé de l’intégration et de la reconnaissance sociale.
La fin du travail figure souvent parmi les prémisses des partisans du revenu de base. Le dépérissement annoncé de l’emploi salarié et l’expansion du travail précaire sont invoqués pour justifier l’instauration d’un revenu de base. Cet argument fait écho aux positions exprimées dans la littérature sur la fin du travail. André Gorz est un des pionniers du concept d’allocation universelle. Le salaire social préconisé par J. Rifkin est une forme particulière de revenu de base. Quant à Erik Brynjolfsson & Andrew McAfee (2015), ils formulent peu de recommandations en matière de politique sociale, si ce n’est un plaidoyer en faveur de l’impôt négatif théorisé dans les années 1980 par Milton Friedman et l’École de Chicago – la version la plus néolibérale du revenu de base.
En Europe, les années 2010 ont constitué un terrain favorable au retour des propositions de mise en place d’un revenu de base, avec un « après-crise 2008 » marqué par un chômage élevé, des perspectives peu optimistes en termes de croissance et d’emploi, des inégalités accrues entre groupes sociaux, des menaces liées à la numérisation. Les visions d’un tel revenu oscillent entre un projet d’utopie mobilisatrice visant à déconnecter le revenu du travail et la requalification de formes d’allocations de remplacement. Une recherche menée en Belgique francophone en 2015 questionnait des jeunes âgés de 18 à 30 ans, actifs ou sans emploi, sur la perspective d’un revenu de base (Vendramin, 2020). Il en ressort une vision réservée et assez critique car celui-ci est d’abord perçu comme une allocation de remplacement qui ne dit pas son nom. Aucune allocation ne semble à même de remplacer l’expérience du travail, ni de procurer la reconnaissance et l’identité dont il est porteur. C’est aussi le travail qui permet de participer à la société et d’acquérir la citoyenneté. Les réponses à l’enquête ISSP 2015 vont dans le même sens avec, en Allemagne, 78 % des jeunes âgés de 18 à 30 ans qui déclarent être d’accord avec la proposition « je souhaiterais avoir un emploi rémunéré même si je n’avais pas besoin d’argent », 70 % des jeunes en France dans la même tranche d’âge partagent cet avis, également 67 % en Belgique, 60 % en Espagne et 74 % en Suède. Postuler une disparition même partielle du travail, compensée par un revenu de base, est un scénario construit sur une conception limitée du travail dans laquelle sa dimension sociale est trop peu présente. Celle-ci constitue plus qu’un puissant frein théorique à des scénarios de disparition du travail, en dépit des potentialités des nouvelles technologies. À ce jour, même si la fonction intégrative du travail semble bien enrayée, aucune alternative ne semble se dessiner, ceci malgré les lourdes incidences sociales. Le travail a été le fondement du lien social des sociétés modernes, jouera-t-il encore ce rôle dans les sociétés mondialisées et numériques ?
Mots-clés : intégration, travail, solidarité, identité sociale
Voir aussi les questions : 24 Le précariat, une nouvelle classe sociale ?, 36 Tous entrepreneurs ?
Bibliographie
- Brynjolfsson Erik & McAfee Andrew, 2015, Le Deuxième âge de la machine. Travail et prospérité à l’heure de la révolution technologique, Paris, Odile Jacob.
- Castel Robert, 1995, Les Métamorphoses de la question sociale. Une chronique du salariat, Paris, Gallimard.
- Durkheim Émile, 2007 [1893], De la division du travail social, Paris, Puf.
- Méda Dominique, 1995, Le Travail, une valeur en voie de disparition, Paris, Aubier (rééd. Flammarion, 1998 et 2010).
- Méda Dominique & Vendramin Patricia, 2013, Réinventer le travail, Paris, Puf.
- Mercure Daniel & Vultur Mircea, 2010, La Signification du travail. Nouveau modèle productif et ethos du travail au Québec, Québec, Presses de l’Université Laval.
- Paugam Serge, 2007, Le Salarié de la précarité. Les Nouvelles Formes de l’intégration professionnelle, Paris, Puf.
- Schnapper Dominique, 1994, L’Épreuve du chômage, Paris, Gallimard.
- Sennett Richard, 2000, Le Travail sans qualités. Les Conséquences humaines de la flexibilité, Paris, Albin Michel [1998 au Royaume uni].
- Valenduc Gérard & Vendramin Patricia, 2019, La Fin du travail n’est pas pour demain, Note de prospective no 6, Bruxelles, European Trade Union Institute, mars.
Vendramin Patricia, 2020, « Rapport au travail des jeunes et revenu inconditionnel », in Mercure Daniel dir., Les Transformations contemporaines du rapport au travail, Québec et Paris, Presses universitaires de Laval et Éditions Hermann, p. 109-124.
Données
- EVS (European Value Survey), 1990, 1998, 2008.
- ISSP (International Social Survey Programme), module spécial « Work Orientation », 2015.
Pour découvrir les 49 autres « questions de sociologie »…
> Retrouvez le livre sur le site des Presses universitaires de France
https://www.puf.com/50-questions-de-sociologie
> Et sur la plate-forme Cairn.info
https://www.cairn.info/50-questions-de-sociologie–9782130820673.htm