Recension : Julie Pagis, Le Prophète rouge. Enquête sur la révolution, le charisme et la domination (2024, La Découverte)
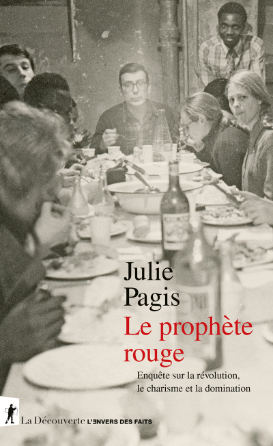
Julie Pagis (2024), Le Prophète rouge. Enquête sur la révolution, le charisme et la domination, Paris, La Découverte, 353 p.
Recension version post-print par
Hugo Trevisan
hugo.trevisan@ehess.fr
Doctorant Ehess, Centre Maurice Halbwachs, École normale supérieure, 48 Boulevard Jourdan, 75014 Paris, France
Dans Le Prophète rouge, Julie Pagis présente un matériau inédit, qui s’inscrit dans la lignée de ses précédents travaux sur les trajectoires sociales post-Mai 68. Contactée par une de ses membres, l’auteure découvre l’histoire d’un groupuscule maoïste actif dans les années 1970, soumis à l’autorité d’un chef, Fernando. Grâce à des archives internes – en particulier les minutes des réunions du collectif – et à des entretiens avec les ancien·nes membres, l’auteure retrace l’histoire du groupe et décrit ses séances d’autocritique et ses démarches de « rectification[1] ». Elle en tire une biographie collective attentive aux trajectoires sociales, dans une double perspective de sociologie du militantisme et de sociologie dispositionnaliste de la conversion. Un autre versant de l’enquête, mobilisant notamment des sources policières et de renseignement, lui permet ensuite de reconstituer la trajectoire biographique sinueuse de ce Fernando au passé mystérieux.
L’ouvrage est une contribution à la discussion sur ce qu’est le charisme. Julie Pagis entend rendre opératoire le concept wébérien de domination charismatique grâce à deux propositions théoriques. D’une part, elle situe cette domination sur un plan micro-sociologique et interactionniste, à travers le recours à la théorie énergétique de Randall Collins[2]. Il s’agit de rendre compte des effets réciproques de l’interaction sur le chef charismatique et sur les « encharismé·es » – un néologisme proposé par l’auteure. D’autre part, elle articule la domination charismatique aux violences de genre et de sexualité, s’inspirant en partie des travaux de Raewyn Connell sur la notion de masculinité hégémonique[3].
À chaque moment de l’enquête correspond une partie de l’ouvrage : la première (chapitres 1 à 6) relate l’histoire du groupe de la rencontre à la dissolution, la seconde (chapitres 7 et 8) est dédiée à la trajectoire de Fernando. Les quatre premiers chapitres couvrent la période allant des débuts du groupe en 1971 à sa radicalisation en 1976. Le premier chapitre situe la rencontre de Fernando par chacun·e des membres dans leurs trajectoires biographiques – caractérisées par ce que l’auteure qualifie d’impasses et par l’attente d’une offre prophétique de salut, à laquelle vient répondre Fernando. C’est pour décrire la forte impression faite par ce dernier sur les futur·es membres que l’auteure mobilise la théorie énergétique de Randall Collins, les interactions étant pensées comme des moments de circulation d’une énergie émotionnelle – au risque d’une certaine psychologisation de la domination. Le deuxième chapitre est consacré à l’établissement maoïste en usine des membres. Les ruptures biographiques et les pratiques de transformation de soi que celui-ci entraîne sont analysées dans une perspective dispositionnaliste. Les séances de critique et d’autocritique marxiste-léninistes sont ainsi décrites comme un dispositif socialisateur et de réflexivité. Le chapitre 3 décrit le resserrement du groupe autour d’un noyau central soumis à Fernando. Diverses pratiques contribuent à la transformation de soi et à la soumission, tel un rituel de serment (moment d’effervescence durkheimienne) ou encore les séances de critique et d’autocritique (qui contribuent au monopole de Fernando sur la vérité). L’auteure montre la dimension genrée des dispositifs répressifs, qui s’exercent d’autant plus fortement sur les femmes. Des exclusions, notamment suite à la fuite de la compagne de Fernando, Aline, victime de violences conjugales, sont décrites comme renforçant mécaniquement la cohésion du groupe et comme socialisant les membres à la violence. On peut d’ailleurs au passage repérer un certain flottement sur ce qui constitue une violence : le terme peut-il s’appliquer de la même façon aux violences conjugales et à l’exclusion d’un groupe militant ? Enfin, le quatrième chapitre fait le récit de l’installation du groupe dans un ancien couvent à Clichy et de leur vie en commun – tandis que Fernando est souvent à l’étranger. L’auteure analyse ce moment comme l’occasion d’une rupture avec les institutions qui accordent habituellement de la valeur aux individus (l’État, la famille ou encore le travail), laissant ainsi une place accrue aux jugements de valeur du chef charismatique. Cette période est celle d’une radicalisation du travail de mise en cohérence de soi, dans un contexte de surveillance de tou·tes par tou·tes et d’instabilité des positions qui mine les solidarités, notamment au sein des couples. C’est ce que montre l’exemple de la crèche collective du groupe, dispositif coercitif qui s’exerce avec la participation de l’ensemble des membres, et qui contribue à la domination sur les mères, à travers la menace d’un retrait de l’accès à leurs enfants.
Les deux chapitres suivants reviennent sur les dernières années du groupe, de 1976 et 1981, à l’aide des concepts d’emprise et de déprise. Le chapitre 5 est consacré à l’accusation de complot contre Fernando dont un membre, Paul, fait l’objet. Cette accusation intervient dans un contexte de jalousie, Fernando pensant que Paul tente de séduire sa nouvelle compagne, situation que l’auteure analyse au prisme de la masculinité hégémonique (Randall Connell). Paul est placé en « garde à vue » et sommé de faire une sorte de thérapie de couple marxiste-léniniste avec sa compagne, Anita, en attendant l’organisation d’un « tribunal populaire » – qui se tient en l’absence de Fernando. La façon dont Fernando fait croire à sa version de l’histoire permet à Julie Pagis de définir le concept d’emprise, complémentaire de celui de domination. Si la domination est la possibilité d’infléchir le comportement des autres, l’emprise désignerait en revanche celle d’infléchir la pensée des autres – possibilité qui passe notamment par la conversion et le travail de transformation de soi. On retrouve ici le risque de la psychologisation, bien que l’auteure rappelle plus haut l’impossibilité pour la sociologie d’accéder à l’intériorité. Le chapitre 6 poursuit la réflexion sur la croyance et sur l’emprise, décrites comme affaiblies par l’absence de Fernando, installé au Portugal. L’auteure décrit le jugement de Paul par un « tribunal populaire » – tribunal dont l’incompréhension par les ouvrier·es sollicité·es pour y participer fait rejaillir la marginalité sociale des pratiques maoïstes. La sortie de Paul et Anita du groupe précède la dissolution de ce dernier par Fernando, malgré le recours de celui-ci à des techniques de persuasion et de manipulation visant à tenter de rétablir un temps son emprise. La soumission de certain·es membres à l’emprise est décrite comme un facteur des troubles psychologiques dont ils et elles souffrent, dont la paranoïa pour l’un d’eux. Enfin, c’est toujours sous l’angle d’une sociologie dispositionnaliste de la conversion que Julie Pagis s’attache à décrire la déprise, processus long et douloureux qui expliquerait la persistance de certaines pratiques ou de certains modes de pensée chez les ancien·nes membres du groupe.
Les deux derniers chapitres de l’ouvrage déplacent la focale sur la traque de Fernando par l’auteure dans les archives policières et des services de renseignement, avec l’aide de divers spécialistes, en France, en Espagne et en Chine. On y apprend surtout que Fernando avait sans doute eu des activités de renseignement et qu’il est donc possible qu’il ait appris des techniques de manipulation. Le secret qui entoure le personnage est l’occasion pour l’auteure d’articuler théoriquement charisme et imposture, afin de résoudre le problème de l’accumulation initiale du capital charismatique. Ces chapitres 7 et 8 soulèvent un certain nombre de questions, notamment quant aux motivations de Fernando – le groupe était-il une couverture pour ses activités de renseignement ? Fernando cherchait-il à s’enrichir au détriment des membres, l’un d’eux l’accusant d’avoir détourné des sommes conséquentes ? – questions qui restent malheureusement sans réponse.
L’originalité du matériau mobilisé constitue une des forces de l’ouvrage, qui se lit parfois comme un roman policier – une caractéristique que l’auteure reconnaît et qui tient peut-être également à la forme filmique un temps envisagée pour rendre compte de l’histoire. Julie Pagis propose une lecture fine des archives du groupe qui permet de se plonger dans le quotidien de ses pratiques du pouvoir. C’est donc sur un appui empirique solide qu’elle interroge à nouveaux frais la question du charisme et de sa transférabilité heuristique à d’autres objets. Cela ne va toutefois pas sans un certain nombre de difficultés. Afin de mieux comprendre les formes de domination à l’œuvre, on souhaiterait par exemple en savoir plus sur l’environnement des membres du groupe : entre les trajectoires prises dans le contexte historique et la micro-sociologie des interactions, il manque parfois le niveau intermédiaire des socialisations militantes quotidiennes des membres du groupe, alors même que des remarques éparses semblent aller dans le sens d’une activité importante du collectif tout au long de son existence.
Mais c’est surtout la tentative de réhabilitation du concept de charisme qui nous semble source de difficultés. Cela tient pour une part au choix d’une lecture typologique de Max Weber, avec une définition « exigeante » du charisme selon cinq critères précis – là où l’idéal-type wébérien est difficile à appliquer au matériau concret, en raison d’une fluidité du réel que Max Weber lui-même reconnaissait. Le concept de charisme évolue d’ailleurs au fil de la carrière de Max Weber – un constat qui justifie pour certain·es l’abandon du concept[4]. En outre, l’auteure affirme régulièrement que l’obéissance des membres serait avant tout fonction de leur croyance en la légitimité de Fernando. Or, Michel Dobry[5] a montré que chez Max Weber, les croyances en la légitimité ne sont qu’un déterminant parmi d’autres de l’obéissance. Enfin, l’idée d’un charisme « pur » de Fernando, qui ne connaîtrait pas la quotidianisation, est d’autant moins convaincante que le contrôle au sein du groupe semble reposer sur de nombreux dispositifs disciplinaires et que la contrainte y est exercée par tou·tes les membres les un·es envers les autres – y compris en l’absence de Fernando. Afin de conserver le concept de charisme, on pourrait ici distinguer le moment de la rencontre initiale – avec une forme de charisme de situation, le prophète Fernando répondant aux attentes des membres – des événements qui suivent, au cours desquels a lieu une forme d’institutionnalisation, quoique précaire.
Une autre complication se situe dans l’analyse de ce qui fait que la domination charismatique prend et se maintient. Sur ce point, on note une contradiction latente entre rejet explicite des analyses intentionnalistes du charisme et idée que l’art – acquis – de l’imposture est peut-être ce qui permet l’accumulation initiale du charisme. Surtout, et Julie Pagis le souligne elle-même, il est difficile d’articuler le niveau micro de l’interaction énergétique entre chef et encharismé·e, et la dimension plus structurelle des ressources et positions de pouvoir – on court alors le risque de la psychologisation et de la reconduction d’une forme de naturalisation du charisme. Une solution possible à ces deux difficultés serait de suivre la proposition de Manuel Schotté citée par l’auteure[6] : arrimer l’épreuve de grandeur de la sociologie pragmatique à la théorie des champs de la sociologie critique. Il s’agirait alors de montrer comment la grandeur de Fernando s’impose et est naturalisée à travers des séries d’interactions contraintes par les positions de pouvoir objectives et donnant lieu à des jugements aux multiples effets – que l’on appelle cette grandeur charisme ou non.
Julie Pagis a choisi une autre voie, et c’est en réponse à celles et ceux qui renoncent au charisme qu’elle propose de réhabiliter le concept. Malgré les difficultés que cela pose, l’ouvrage a le mérite de s’appuyer sur une riche synthèse des travaux sur la question et d’offrir matière à réflexion.
- Une partie du matériau avait auparavant fait l’objet d’un mémoire de master, sous la direction de Julie Pagis. Margot Roisin-Jonquières (2018), « Se transformer en, venir en aide à, lutter avec. Pratiques de décloisonnement social d’un groupe d’établi·es (1971-1983) », M2 Sociologie générale, Ehess. ↑
- Randal Collins (2020), Charisma. Micro-sociology of Power and Influence, New York, Routledge. ↑
- Raewyn Connell (2014), Masculinités : enjeux sociaux de l’hégémonie, Paris, Éditions Amsterdam. ↑
- Isabelle Kalinowski (2016), « Max Weber et la nature du charisme », Sensibilités, no 1, p. 11-25. ↑
- Michel Dobry (2003), « Chapitre 6. Légitimité et calcul rationnel. Remarques sur quelques “complications” de la sociologie de Max Weber », in Être gouverné. Études en l’honneur de Jean Leca, Paris, Presses de Sciences Po, p. 127-147. ↑
- ManuelSchotté (2016), « L’économie de la grandeur », Sensibilités, no 1, p. 26-37. ↑