Recension : Delphine Serre, Ultime Recours. Accidents du travail et maladies professionnelles en procès (2024, Raisons d‘agir)
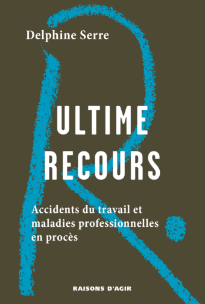
Delphine Serre (2024), Ultime Recours. Accidents du travail et maladies professionnelles en procès, Paris, Raisons d‘agir, 192 p.
Recension version post-print par
Lise Kayser
lise.kayser@univ-nantes.fr
Doctorante au Centre nantais de sociologie (Cens), UMR 6025, Chemin de la Censive du Tertre, 44312 Nantes cedex 3, France
Le 10 mai 2007, la Cour de cassation opère un revirement de jurisprudence en reconnaissant comme accident du travail le suicide d‘une salariée victime de harcèlement moral, survenu à son domicile[1]. Par cette décision, les juges mobilisent leur pouvoir d‘interprétation du droit en considérant que, bien que l‘acte ne se soit pas produit sur le lieu ou durant le temps de travail, il trouve son origine dans l‘activité salariale et doit donc être indemnisé au titre de la législation sur les risques professionnels. La scène judiciaire constitue ainsi un observatoire privilégié des luttes de définition qui entourent le droit à la réparation des maux du travail. Pourtant, les tribunaux avaient jusqu‘ici été négligés dans les recherches portant sur le processus de qualification des atteintes à la santé d‘origine professionnelle. Cette littérature, très dynamique depuis les années 2000, a documenté les nombreux obstacles qui entravent la reconnaissance des maladies professionnelles et des accidents du travail, depuis le renoncement au droit[2] jusqu‘aux conflits autour de la codification des pathologies[3] en passant par les réticences des médecins à rédiger des certificats[4]. En s‘intéressant aux tribunaux des affaires sociales (TASS), intégrés depuis 2019 au « pôle social » du tribunal judiciaire, Delphine Serre éclaire, dans son nouvel ouvrage, le dernier maillon de la chaîne de la réparation des risques du travail.
Les trois premiers chapitres dressent le portrait des différents justiciables qui saisissent le tribunal : les employeurs et leurs avocat·es, les salarié·es se défendant seul·es, puis ceux et celles accompagné·es par un·e avocat·e. Le quatrième chapitre examine la manière dont les caisses primaires d‘assurance maladie (CPAM) défendent leurs décisions face aux attaques croisées des employeurs et des salarié·es. Les deux derniers chapitres détaillent les pratiques des juges et montrent comment, en cherchant à corriger des inégalités de classe, ils et elles reconduisent une vision andro-ouvriériste de la pénibilité du travail.
L‘analyse repose principalement sur une enquête menée entre 2015 et 2021 dans huit juridictions de la France hexagonale. Pour saisir la production des décisions de justice, l‘enquête a inclus l‘observation d‘une trentaine d‘audiences, la rencontre d‘une quinzaine de juges et la réalisation d‘une trentaine d‘entretiens avec des professionnel·les du droit (assesseur·es, représentant·es des caisses, avocat·es des employeurs et des salarié·es). En parallèle, grâce à une convention avec le ministère de la Justice, l‘auteure a exploité un corpus documentaire constitué de l‘intégralité des décisions rendues en juin 2017 sur l‘ensemble du territoire national concernant les demandes de reconnaissance d‘accidents du travail (160 cas) et de maladies professionnelles (235 cas), ainsi que la moitié de celles relatives à la contestation des accidents du travail (229 cas).
Le premier chapitre porte sur les situations les plus fréquentes au TASS : la contestation des accidents du travail et des maladies professionnelles (AT-MP) par les grandes entreprises. Celles-ci cherchent à réduire leurs taux de cotisations[5] en attaquant les décisions des CPAM. Lorsqu‘un employeur parvient à faire invalider une reconnaissance d‘AT-MP, le coût du sinistre est transféré sur un compte mutualisé entre tous les employeurs, allégeant ainsi sa charge financière individuelle. Cette stratégie s‘avère rentable : en 2021, les grandes entreprises ont généré 37,8 % des dépenses de la branche AT-MP, mais n‘ont payé que 31,5 % des cotisations. Depuis les années 2000, ces pratiques d‘optimisation se sont intensifiées avec l‘essor de cabinets d‘avocats spécialisés, jusqu‘à ce qu‘un délai de recours de deux mois, instauré en 2010, limite la multiplication des contestations. Pour maximiser leurs chances d‘obtenir l‘invalidation d‘une reconnaissance d‘AT-MP, les avocat·es des employeurs s‘appuient sur un arsenal juridique bien rodé, fondé principalement sur l‘exploitation des failles de procédure.
À l‘inverse, les salarié·es qui saisissent le tribunal sont bien plus démuni·es. Le deuxième chapitre expose les difficultés auxquelles ils et elles sont confronté·es lors de la contestation en justice du rejet de leur demande de reconnaissance d‘AT-MP. La plupart des salarié·es se présentent seul·es, sans avocat·e, et naviguent dans une procédure dont ils et elles maîtrisent mal les exigences. Leur requête est souvent formulée en décalage par rapport aux critères fixés par le droit. Tandis que la logique juridique cherche à établir l‘existence d‘un événement déclencheur de l‘accident du travail ou à vérifier la conformité d‘une pathologie aux tableaux des maladies professionnelles, les salarié·es mettent principalement en avant leur ressenti face à la douleur, leur conviction intime d‘un lien avec le travail et la responsabilité de l‘employeur dans la dégradation de leur santé.
La présence d‘un avocat aux côtés des salarié·es augmente leurs chances d‘obtenir gain de cause, grâce à une mise en forme de leur requête conforme aux attentes légales. Toutefois, l‘auteure souligne dans un troisième chapitre que ce contentieux est peu attractif pour les avocat·es défendant les salarié·es. Le droit de la sécurité sociale est perçu comme très technique et répétitif, peu lucratif et exigeant sur le plan émotionnel en raison de la vulnérabilité des justiciables qu‘ils et elles accompagnent. Certaines affaires sont néanmoins prises en charge par des avocat·es engagé·es auprès d‘associations de défense des victimes, comme celles de l‘amiante, où leur expertise permet de structurer des actions judiciaires collectives particulièrement efficaces, notamment en matière de faute inexcusable de l‘employeur dont la reconnaissance entraîne une majoration de la rente touchée par les victimes. Cependant, cette spécialisation reste concentrée sur des dossiers spécifiques, tandis que les troubles musculo-squelettiques ou les affections psychiques, plus complexes à défendre, ne bénéficient pas du même degré d‘expertise.
Dans le contentieux des AT-MP, employeurs et salarié·es ne s‘opposent pas frontalement, chacun étant confronté à la sécurité sociale. L‘auteure consacre le quatrième chapitre aux représentant·es de la CPAM – juristes salarié·es de la caisse ou, plus rarement, avocat·es – chargé·es de défendre devant le tribunal les décisions prises par l‘institution. Selon les cas, leur rôle est de confirmer un refus de prise en charge face aux salarié·es ou de soutenir la reconnaissance d‘un accident du travail ou d‘une maladie professionnelle face aux employeurs. Les représentant·es de la CPAM bénéficient d‘un triple avantage en audience : ils et elles maîtrisent les règles juridiques en tant que professionnel·les du droit, disposent des ressources institutionnelles de la caisse et occupent une position de « joueur répété[6] », confronté·es régulièrement à ce type de contentieux. Cette position dominante les conduit à adopter une posture offensive face aux avocat·es des employeurs, en raison des enjeux financiers considérables que ces litiges représentent pour les caisses. En revanche, vis-à-vis des salarié·es, leur approche repose sur une « pédagogie du refus » : en cherchant à expliquer les règles en vigueur, ils et elles inculquent un rapport résigné au droit et ferment toute possibilité de contestation.
Dans les deux derniers chapitres, Delphine Serre s‘intéresse aux juges et à la manière dont ils et elles investissent leur rôle lorsqu‘il s‘agit de statuer sur la reconnaissance des affections liées au travail. Elle souligne d‘abord que cette spécialisation est rarement un choix : les TASS pâtissent d‘une image négative en raison d‘un droit perçu comme rigide qui ne laisse que peu de marge de manœuvre aux magistrats. Cependant, certain·es juges revendiquent une posture interprétative à l‘égard de la loi, dans un souci de rééquilibrer les rapports de force en présence. Une attention particulière est accordée aux salarié·es se présentant sans avocat·e, à qui les juges donnent parfois des indications pour mieux préparer leur dossier. Cette bonne volonté est toutefois à géométrie variable. D‘une part, les victimes d‘accidents physiques bénéficient d‘un traitement plus favorable que les victimes d‘atteintes psychiques. D‘autre part, les femmes ont moins de chances de voir leur affection reconnue que les hommes, en raison de référentiels juridiques élaborés à la fin du xixe siècle selon un modèle ouvrier masculin, qui peinent à s‘adapter aux contraintes professionnelles féminines. En effet, les femmes occupent plus souvent des postes où les efforts physiques sont continus, répétés et non spectaculaires, ce qui complique l‘identification d‘un événement déclencheur pouvant caractériser un accident du travail. Les habitudes jurisprudentielles reconduisent ainsi une hiérarchie des maux du travail qui donne le primat aux travailleurs masculins, en invisibilisant les pénibilités rencontrées par les femmes dans les métiers de service[7].
Ce dernier résultat est sans doute le plus fort de l‘ouvrage. Delphine Serre parvient à nuancer une perspective souvent mécaniciste de la justice en tant qu‘institution de reproduction sociale, en montrant que certain·es juges peuvent bel et bien repérer les inégalités qui pèsent sur les justiciables et tentent de les corriger, mais que leur sollicitude est d‘abord dirigée vers les hommes qui exercent un travail manuel et qui sont victimes d‘accidents physiques. Dévoiler le traitement différentiel des maux du travail sur la scène judiciaire constitue une avancée majeure dans l‘identification des obstacles rencontrés par les femmes dans la prise en charge institutionnelle de leurs affections professionnelles. Toutefois, on peut se demander si l‘appartenance de genre des juges fait varier cette disparité du regard porté sur les justiciables : les femmes juges sont-elles plus enclines à exprimer une forme de « solidarité de genre[8] » vis-à-vis des femmes requérantes et dans quelles conditions ? Pour conclure, il faut souligner la qualité de synthèse de l‘ouvrage, qui réussit, dans un format réduit, à faire état d‘une institution jusqu‘ici très peu décrite par la littérature, où se joue pourtant la question centrale de ce que coûtent les dégâts du travail aux employeurs qui en sont responsables, et aux salarié·es qui en sont victimes.
- Cass. soc., 10 mai 2007, no 05-44.806. ↑
- Anne Marchand (2016), « Quand les cancers du travail échappent à la reconnaissance », Sociétés contemporaines, no 102, p. 103‑128. ↑
- Rémy Ponge (2020), « Un droit des corps meurtris. Retour sur les ressorts de la résistance du système des tableaux aux souffrances psychiques », in Catherine Cavalin et al. (dir.), Cent ans de sous-reconnaissance des maladies professionnelles, Paris, Presses de l‘Ecole des Mines, p. 107‑124 ; Marc-Olivier Déplaude (2003), « Codifier les maladies professionnelles : les usages conflictuels de l‘expertise médicale », Revue française de science politique, vol. 53, no 5, p. 707‑735. ↑
- Sylvain Brunier, Jean-Noël Jouzel et Giovanni Prete (2022), « Réparer les vivants plutôt que les torts. L‘organisation de la médecine hospitalière et la sous-déclaration des hémopathies professionnelles », Sciences sociales et santé, vol. 40, no 1, p. 5‑30 ; Julie Primerano (2020), « La mise en actes du droit de la réparation des cancers professionnels : lire et façonner les corps », Revue française des affaires sociales, no 2020/3, p. 69‑87. ↑
- Pour les entreprises de plus de 150 salarié·es, le montant des cotisations AT-MP est individualisé en fonction de la sinistralité : plus l‘entreprise enregistre de sinistres et plus ils sont graves, plus ses cotisations sont élevées. ↑
- Marc Galanter (2013), « “Pourquoi c‘est toujours les mêmes qui s‘en sortent bien ?” : réflexions sur les limites de la transformation par le droit », Droit et société, traduit par Liliane Umubyeyi et Liora Israël, no 85, p. 575‑640. ↑
- Pour un développement sur ce sujet, lire : Delphine Serre (2021), « Une attention aux “démunis” aveugle au genre », Actes de la recherche en sciences sociales, no 236-237, no 1, p. 54‑71. ↑
- La notion de « solidarité de genre » est dépliée dans les travaux précédents de l‘auteure. Delphine Serre (2012), « Travail social et rapport aux familles : les effets combinés et non convergents du genre et de la classe », Nouvelles Questions féministes, vol. 31, no 2, p. 49‑64. ↑