Recension : Jean Le Bihan, Bourses et boursiers de l’enseignement secondaire en France (2024, Presses universitaires de France)
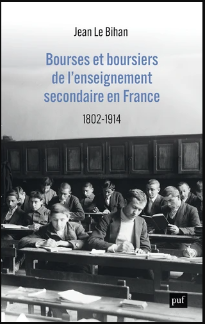
Jean Le Bihan (2024), Bourses et boursiers de l’enseignement secondaire en France, Paris, Presses universitaires de France, 496 p.
Recension version post-print par
Arnaud Pierrel
arnaud.pierrel@parisnanterre.fr
Maître de conférences en sociologie, Université Paris Nanterre, UMR 8533-Institutions et dynamiques historiques de l’économie et de la société ; IDHE.S, Université Paris Nanterre, bâtiment Max Weber (W), 200 avenue de la République, 92001 Nanterre cedex, France
Une photo de classe des boursiers du XIXe siècle
Les témoignages bien connus des boursiers héroïques de la Troisième République et les romans des détracteurs conservateurs des « déracinés » sont les arbres qui cachent la forêt des boursiers du long xixe siècle. C’est au sein de cette forêt que nous invite à pénétrer l’ouvrage de Jean Le Bihan, version remaniée du mémoire inédit de l’habilitation à diriger des recherches d’histoire soutenue par l’auteur en 2022.
La vue d’ensemble que propose l’auteur implique quatre choix de cadrage. Pour se défaire de la « figure du boursier conquérant » (p. 13), le moyen le plus sûr est d’embrasser l’ensemble du XIXe siècle, depuis la création des bourses d’État en 1802 et jusqu’en 1914, sans focalisation chronologique sur la Troisième République. L’articulation des échelles géographiques nationale et locale (le « test rennais » selon l’expression récurrente de l’auteur) qui parcourt l’ouvrage restitue la diversité de la population boursière mieux que ne le ferait une approche strictement monographique. Ensuite, l’enquête s’inscrit certes dans une perspective institutionnaliste de la scolarisation[1], comme le montrent l’architecture générale du livre et l’ordre des substantifs de son titre où, dans les deux cas, « l’offre » (les bourses) précède et conditionne « la demande » (les boursiers). Le propos fait donc la part belle aux évolutions réglementaires de l’offre de bourses, mais il intègre également pleinement les boursiers et leurs familles par une approche sociographique minutieuse. Enfin, l’auteur focalise son analyse sur les garçons des lycées d’État et laisse donc de côté les élèves des collèges communaux, éligibles aux bourses après 1868, et les jeunes filles des lycées et collèges, pouvant quant à elles postuler à partir de 1882.
L’ampleur des sources convoquées est à la hauteur de ces choix de cadrage. La réglementation des différents types de bourses est scrutée dans ses moindres détails, des réformes structurantes aux projets restés lettre morte en passant par les mesures éphémères. Le contexte d’élaboration des textes administratifs nationaux est bien rendu par la mobilisation des débats et des enquêtes parlementaires, ainsi que divers articles et opuscules s’intéressant à la question. La réception et l’application de ces réglementations successives sont analysées à partir des représentants locaux de l’État (préfets et recteurs d’académies) et des archives des directions des lycées (notamment, mais pas uniquement, celui de Rennes). Enfin, Jean Le Bihan a conduit un impressionnant travail prosopographique, à la fois à l’échelle nationale, à partir des ordonnances et des listes de nomination de plus de 10 000 boursiers, et à l’échelle locale du lycée de Rennes, en recoupant de multiples sources informant aussi bien du recrutement que du devenir d’une centaine de boursiers[2]. Il faut souligner le rapport toujours précautionneux aux sources, Jean Le Bihan indiquant systématiquement lorsque telle interprétation apparait plausible mais fragile au regard des archives disponibles.
Une bourse n’en vaut pas une autre
Les trois chapitres qui composent la première partie de l’ouvrage restitue les transformations de l’offre de bourses au cours du siècle, sous le double prisme de la diversification des types de bourses et de l’évolution des conditions d’attribution. À leur création en 1802, toutes les bourses sont des bourses entières pour les pensionnaires des lycées. Cette homogénéité est éphémère, puisque dès 1805 les bourses deviennent fractionnables en demis et trois quarts. Ces modulations permettent un « découplage entre nombre de bourses et nombre de boursiers » (p. 37) dans un contexte budgétaire strictement encadré. Le nombre de boursiers est ainsi systématiquement supérieur au nombre de bourses entières. Le ratio est d’environ 1,5 sous la Restauration, il augmente jusqu’à 1,8 en 1848, puis diminue aux alentours de 1,3 à la fin du XIXe siècle. La diversification selon le régime des élèves intervient plus tardivement que celle selon la quotité, puisque les externes et demi-pensionnaires deviennent éligibles aux bourses d’État à partir de 1881.
Mais cette diversification de l’offre n’implique pas celle des publics boursiers, car les conditions d’attribution évoluent similairement pour les différents types de bourses, intégrant progressivement la compétence scolaire des candidats. Dans la première moitié du siècle, la bourse ne récompense pas tant l’élève que son père, moins pour un soutien partisan au régime en place que pour son dévouement de fonctionnaire. Les premiers contrôles du niveau scolaire des candidats, sous la Restauration puis la Monarchie de Juillet, n’ont pas pour vocation « de dégager une élite de collégiens », mais de prévenir « la nomination d’élèves excessivement médiocres » (p. 85). Le critère de la compétence scolaire gagne du terrain sous la Troisième République, sans pour autant devenir hégémonique. En particulier, le principe de l’examen plutôt que du concours est conservé, en tant qu’il permet à la commission nationale de classement des lauréats de disposer d’un important pouvoir discrétionnaire qu’aurait rendu caduc un strict ordre du mérite scolaire. La situation économique des familles a, tout au long du siècle, fait l’objet d’« interprétations administratives passablement divergentes » (p. 115), notamment selon l’éloquence des intercesseurs, qu’il s’agisse de plaider la cause d’une famille dans le dénuement ou, plus fréquemment, de situations chancelantes au gré des conjonctures économiques ou des campagnes militaires, par exemple à la suite du décès précoce du père.
Seuls deux dispositifs connexes aux bourses d’État ciblent un type de public en particulier. Sans entrer dans les détails techniques, les dégrèvements de frais de pension ou de trousseau sont attribués aux élèves des familles les plus démunies et aux résultats ainsi qu’à la conduite scolaire irréprochables. Se retrouvent ainsi ici les boursiers parmi les boursiers si l’on peut dire, ceux qui correspondent au « modèle hoggartien » du transfuge de classe[3], mais qui représentent donc bien davantage l’exception que la règle. En parallèle se met en place un système de remise de droit, d’abord pour les fils de militaires et de professeurs de lycée, puis, non sans débats, pour les fils d’instituteurs. Ces avantages catégoriels ne sont pas anecdotiques. D’une part, ils illustrent comment se construit en pratique la commune appartenance à l’État des différents corps de fonctionnaires. D’autre part, ils constituent le contre-exemple par excellence de la figure mythifiée du boursier de la République radicale, puisque ces remises de droit détournent de l’incertain examen des bourses bon nombre de fils d’enseignants (p. 169).
L’on peut regretter le choix de titre pour le chapitre consacré à ces dispositifs connexes, « En marge des bourses ». En effet, les dégrèvements et les remises ne sont marginaux ni par leur volume, représentant un budget faisant jeu égal avec celui des bourses d’État, ni par leur fonction de complément ou de substitut aux bourses proprement dites comme le montre très bien le chapitre. En revanche, leur conception même peut être qualifiée de marginale, en tant qu’ils sont destinés à des types de publics en particulier du point de vue des origines sociales, alors que les bourses d’État ne ciblent pas explicitement des catégories d’élèves précises.
Des boursiers fils du peuple ?
La deuxième partie de l’ouvrage propose une sociographie détaillée des lycéens boursiers. L’auteur les suit successivement avant, pendant et après la perception de leur bourse. Cette organisation permet d’aborder de multiples facettes des parcours, mais laisse parfois en arrière-plan la diversité de ces derniers au profit d’une description d’un parcours modal, celui d’un fils de fonctionnaire bon élève devenant à son tour fonctionnaire, en légère ascension sociale.
Cette description sommaire du parcours modal doit cependant être affinée, car la population boursière se recompose au fil du siècle. Quatre grandes tendances sont repérables à partir des trois cohortes qu’étudie l’auteur : 1834-1841, 1884-1890 et 1906-1912. Premièrement, les boursiers sont de plus en plus issus des classes populaires dans la seconde moitié du siècle. Alors que les enfants d’origines populaires représentent 5 % de la cohorte boursière nommée entre 1834 et 1841, ils deviennent majoritaires dans celle accédant à la bourse entre 1906 et 1912 (56 %). Deuxièmement, si la population boursière du début de la période est presque exclusivement composée de fonctionnaires (87 % pour la cohorte 1834-1841), elle provient ensuite davantage des classes salariées du privé, notamment liées au monde du rail. Troisièmement, les boursiers se recrutent de plus en plus dans les écoles primaires, quoique cette tendance demeure tardive et relative. Enfin, les origines géographiques des boursiers cessent peu à peu de surreprésenter les espaces urbains pour mieux intégrer des enfants des bourgs. Pour autant ces quatre tendances ne s’accompagnent pas d’une baisse du niveau scolaire des boursiers qui, au contraire, s’accroît légèrement, à mesure que ce niveau devient le critère principal de recrutement des boursiers. L’obtention du baccalauréat devient la norme pour les boursiers de la Troisième République et le développement des classes préparatoires participe aussi à rehausser le niveau scolaire moyen des boursiers.
Ces évolutions vont de pair avec certaines permanences. D’abord, si le niveau scolaire moyen des boursiers augmente, il demeure fortement hétérogène. La progression dans la quotité de bourses d’une demi-bourse à une bourse entière, sur le modèle de l’avancement des fonctionnaires, permet d’ailleurs de distinguer la « minorité du meilleur » au fil des parcours dans l’enseignement secondaire. Les boursiers ne se retrouvent donc pas seulement aux places d’honneur, bien qu’ils évitent généralement les places de cancres, d’après l’analyse faite pour le « test rennais » sur le classement des boursiers au sein de leur classe et sur les remises de prix. Cette distinction par la négative se comprend à l’aune d’une autre constante, la surveillance plus stricte par leurs homologues payants, les boursiers étant « censés faire la preuve permanente de leur droit à continuer de jouir des faveurs de l’État » (p. 249). Ensuite, la demande de bourse requiert une mobilisation familiale conséquente, qui suppose un minimum de compétences écrites et administratives et, surtout, un rapport au temps relativement détaché des urgences du quotidien, car le temps d’attente entre la candidature et l’obtention de la bourse est souvent long.
Les « boursiers locaux » bénéficiaires de bourses communales ou départementales auxquels la troisième partie de l’ouvrage est consacrée, ne diffèrent que peu des boursiers d’État sous l’angle des origines sociales et du niveau scolaire, en dépit d’une sélectivité bien moindre. Ils sont cependant moins souvent fils de fonctionnaires et plus fréquemment issus du monde de la boutique. Étant plus souvent d’origines populaires que les boursiers d’État, leurs devenirs manifestent une mobilité sociale ascendante un peu plus fréquente.
À qui profitent les bourses ?
Deux notations reviennent au fil de l’ouvrage, mais sans pleinement aboutir. D’une part, le système des bourses est pris dans un mouvement plus large de rapprochement des ordres d’enseignement primaire et secondaire. D’autre part, l’obtention d’une bourse ne conduit aux catégories intermédiaires et a fortiori supérieures que si elle va de pair avec un certain capital de départ. Jean Le Bihan montre par exemple la corrélation positive entre le montant des successions laissées par les pères et le taux d’accès aux catégories supérieures et intermédiaires pour les fils boursiers (p. 318). Autre manière de souligner que les boursiers parmi les boursiers, correspondant au modèle hoggartien du transfuge, sont l’exception et non la règle.
Ces deux propositions récurrentes gagnent à être liées et soulèvent des questions tant factuelles que de construction d’objet. Le rapprochement des ordres d’enseignement primaire et secondaire par le truchement des bourses s’effectue mécaniquement au détriment des offres alternatives de scolarisation post-primaires, notamment l’enseignement technique et l’enseignement primaire supérieur dont on sait à quel point ils ont contribué à l’allongement des scolarités sous la Troisième République[4]. Comment cette concurrence est-elle gérée à l’échelle locale ? Du point de vue des familles, devant l’incertitude de l’obtention d’une bourse de lycée, d’autres destins scolaires, dans le primaire supérieur ou l’enseignement professionnel, constituent-ils des solutions de repli ? Une étude plus approfondie des lettres de candidature et de relance adressées à l’administration par les familles, brièvement mentionnées dans le chapitre 4, aurait vraisemblablement permis de renseigner ces aspirations et projections des familles au sein du paysage d’ensemble de l’offre scolaire post-primaire.
C’est en laissant en suspens ces questions relatives au paysage d’ensemble de l’offre scolaire que la restriction de la construction d’objet autour des boursiers garçons lycéens trouve sa limite principale. L’interrogation vaut d’autant plus pour les familles les plus populaires, précisément puisque le rendement scolaire de la bourse s’avère fortement conditionné par les ressources familiales initiales. La prosopographie des boursiers aurait pu à cet égard aboutir à dégager des configurations représentatives selon les milieux d’origines, quitte à « risquer l’interprétation » plus avant, afin de donner à voir plus concrètement le poids des origines et des contextes locaux d’offre scolaire dans la différenciation des destins des boursiers et comment les uns et les autres se représentent les différents ordres d’enseignement, plus ou moins articulés ou, au contraire, cloisonnés, ainsi que plus ou moins possibles et souhaitables. Faute de quoi, la diversité des boursiers est dans l’ouvrage davantage décalquée des différentes dispositions réglementaires que déduite des configurations familiales. Si la bourse comme moyen de prévention d’un déclassement social est très bien décrite en tant qu’elle constitue la situation modale, on se figure plus difficilement sa place dans les aspirations et les destins des familles les plus populaires et, ce faisant, son rôle dans le mouvement d’allongement des scolarités au-delà du primaire. L’absence d’explicitation de la mise en correspondance entre le code socioprofessionnel présenté en annexe et la tripartition entre classes supérieures, « moyennes » et populaires, ainsi que l’oscillation des usages entre l’une et l’autre nomenclatures, participent également à la mise en arrière-plan de la diversité des configurations familiales.
En définitive, l’ouvrage réussit pleinement et par différents chemins à remettre en cause la figure du boursier transfuge, mais davantage en lui substituant celle du « boursier lambda » (p. 448) qu’en interrogeant la diversité des usages sociaux des bourses selon les milieux d’origine.
- Jean-Pierre Briand, Jean-Michel Chapoulie (1993), « L’institution scolaire et la scolarisation : une perspective d’ensemble », Revue française de sociologie, vol. 34, no 1, p. 3-42. ↑
- Ce travail prosopographique approfondi des boursiers rennais a d’ailleurs donné lieu à la publication en parallèle du présent ouvrage d’un dictionnaire biographique. Voir Jean Le Bihan (2024), Des boursiers du lycée de Rennes au xixe siècle, Rennes, Amélycor. ↑
- Richard Hoggart (1970 [1957]), La Culture du pauvre, Paris, Minuit ; Paul Pasquali, Olivier Schwartz (2016), « La Culture du pauvre : un classique revisité », Politix, no 114, p. 21-54. ↑
- Jean-Pierre Briand, Jean-Michel Chapoulie (2011 [1992]), Les Collèges du peuple, Rennes, Presses universitaires de Rennes. ↑