Recension : Victor Collard, Pierre Bourdieu. Genèse d’un sociologue (2024, CNRS Éditions)
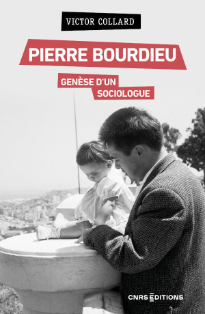
Victor Collard (2024), Pierre Bourdieu. Genèse d’un sociologue, Paris, CNRS Éditions, 448 p.
Recension version post-print par
Charles Soulié
charles.soulie@neuf.fr
Maître de conférences en sociologie, Université Paris 8, Centre européen de sociologie et de science politique ; CESSP, Université Paris 8, Département de sociologie, 2 rue de la Liberté, 93526 Saint-Denis cedex, France
Dans cet ouvrage riche, dense et bien pensé, Victor Collard retrace la trajectoire scolaire, intellectuelle de Pierre Bourdieu depuis son enfance jusqu’à ses premiers travaux en sciences sociales. Ce faisant, il poursuit deux objectifs : celui de rendre raison d’une trajectoire scolaire prestigieuse à laquelle son milieu ne le prédestinait guère, comme celui d’expliquer son passage de la philosophie à la sociologie.
Pierre Bourdieu est né en 1930 dans un petit village du Béarn et à cinq ans, il parle davantage le béarnais que le français. Ce pourquoi plus tard il dira qu’il n’était pas « né dans la scolastique ». Son père scolarisé jusqu’à 14 ans connait néanmoins une certaine ascension sociale attendu qu’il commence à travailler comme métayer, devient facteur, puis receveur des postes. Et il épouse une femme originaire d’une grande famille paysanne scolarisée jusqu’à l’âge de 16 ans.
À l’école primaire et en raison de la trajectoire de transfuge de son père, P. Bourdieu expérimente une relation de proximité distante avec ses camarades pour la plupart fils d’agriculteurs, d’ouvriers, ou de petits commerçants. En 1941, il est « premier de canton » au certificat d’études primaires. Ce qui lui ouvre les portes du lycée Louis Barthou de Pau. Mais arrivé dans cet établissement, il fait l’expérience d’une différence sociale inversée avec les citadins « bourgeois » sachant que le vécu de l’internat est particulièrement traumatisant pour lui, son indiscipline chronique et sa participation à diverses rixes manquant de le renvoyer à l’approche du baccalauréat. En 1948, il passe brillamment le baccalauréat alors qu’à cette date 5,1 % d’une classe d’âge l’obtient.
Pour expliquer sociologiquement cette réussite scolaire improbable, Victor Collard souligne déjà l’importance du facteur du genre. Car à l’époque, être un garçon ou une fille détermine des chances très différentes de poursuivre une scolarité plus ou moins longue. Il note aussi qu’en raison de la dernière profession exercée par le père, la famille Bourdieu occupe une position relativement privilégiée dans le sous-espace villageois, et qu’elle s’investit fortement dans la scolarité de cet enfant unique adoré par sa mère et poussé par son père.
De même très tôt, P. Bourdieu est repéré par l’institution scolaire, en particulier par le proviseur du lycée de Pau, Bernard Lamicq, un normalien d’origine populaire qui lui apprend l’existence de l’École normale supérieure. En 1947, P. Bourdieu reçoit le premier accessit du prix de version latine au concours général, ce qui augmente sa confiance en lui et lui ouvre la porte des classes préparatoires.
En 1948 il entre « en prépas » à Louis-le-Grand, alors meilleure khâgne de France. Victor Collard note que, au regard de son profil social, P. Bourdieu n’est pas si éloigné de celui des khâgneux des années 1930 décrits par Jean-François Sirinelli, même s’il est l’un des 8 boursiers de sa classe d’hypokhâgne qui parmi ses 57 élèves compte nombre d’héritiers parisiens socialisés de longue date à l’art des élégances culturelles.
Victor Collard s’attarde ensuite sur les singularités de l’apprentissage en classes préparatoire tout entier placé sous le signe de l’urgence. La préparation au concours, en philosophie par exemple, n’incite guère à lire les œuvres, mais plutôt à apprendre des argumentaires, notions toutes faites, immédiatement mobilisables dans le cadre des épreuves scolaires : d’où un « usage faible des œuvres » paradoxalement dénoncé par les jurys de concours.
Lors de ces études, P. Bourdieu privilégie notamment le latin plus rentable au concours et moins « imprévisible » que la philosophie. Ainsi, il reconnaitra plus tard avoir « fait les choix de bon élève ». Néanmoins en classes préparatoires, c’est en philosophie qu’il obtient les meilleurs résultats. Et l’enseignement reçu en khâgne qu’il critiquera fortement plus tard, laissera une trace durable chez lui, notamment dans ses manières de construire un discours, une argumentation.
En 1951 et après sa seconde tentative, P. Bourdieu intègre l’École normale supérieure. Étudiant le recrutement social de cette école, Victor Collard note qu’à l’époque elle est encore relativement ouverte aux enfants d’employés. Dans sa promotion de 26 élèves, P. Bourdieu, sous le critère des revenus de ses parents, se situe au 20e rang. Après avoir intégré cette école, il opte pour la philosophie. Pour Victor Collard, ce choix de la discipline considérée comme la plus prestigieuse est une conséquence quasi-mécanique de sa réussite scolaire antérieure. Plus exactement, le déterminant de ce choix serait à chercher dans les gratifications objectives obtenues en philosophie lors des années de classes préparatoires.
Pierre Bourdieu suit alors des cours de philosophie à la Sorbonne et obtient notamment un certificat de morale et sociologie, mais aussi en psychologie, ethnologie. Arrivé au niveau du diplôme d’études supérieures (l’actuel master 1), il choisit de travailler sur Leibniz en proposant une traduction préfacée, annotée et commentée, des Animadversiones. Son premier amour philosophique est donc pour un hyperrationaliste, dont il discutera d’ailleurs plus tard avec passion avec Jean-Claude Passeron. Ce choix est également stratégique, car Leibniz est un des auteurs inscrits au programme de l’agrégation de philosophie, où P. Bourdieu est reçu septième en 1954.
Après l’agrégation, P. Bourdieu choisit un sujet de thèse plus original, décidant de travailler, non pas sur un auteur, mais sur « Les structures temporelles de la vie affective ». Ce sujet situé à l’intersection de la phénoménologie dans sa version la plus rigoureuse et de l’histoire comme de la philosophie des sciences, le conduit notamment à lire de la psychologie, physiologie et par là à réintroduire le corps. Il entame ce travail sous la direction de Georges Canguilhem, un normalien d’origine populaire à l’accent rocailleux qui sur ses cartes de visite se présentait d’ailleurs comme un « philosophe-laboureur ». On retrouve les affinités d’habitus qui joueront un rôle si important dans ses choix intellectuels.
Sa carrière philosophique semble alors toute tracée. Mais il doit d’abord enseigner en lycée, ce qui ne l’enthousiasme guère. L’année 1954 où il est affecté au lycée Théodore de Banville de Moulins est manifestement marquante pour nombre de ses élèves. En effet, il fait preuve alors d’un investissement pédagogique total. Par exemple, il profite de la pause méridienne pour proposer des « topos de culture générale » supplémentaires à ses élèves, fait des conférences d’instruction civique, décore la salle de cours avec des œuvres d’art, aide les élèves à confectionner le journal du lycée, leur fait lire le journal Le Monde (dont il ignorait lui-même l’existence avant d’arriver en classes préparatoires) ainsi que Le Manifeste du parti communiste. Ce qui déclenche d’ailleurs un rappel à l’ordre de son proviseur auquel il tient tête, manifestant alors une certaine tendance à « l’insubordination ».
Mais en octobre 1955, il est réquisitionné pour faire son service militaire de 18 mois en Algérie, pays en guerre depuis bientôt une année. Au début, il est affecté à une mission de surveillance d’un dépôt d’explosifs situé à 200 km d’Alger. Mais grâce à l’intervention d’un colonel béarnais ami de sa famille, il est nommé « rédacteur concepteur » au sein du service d’information du Gouvernement général à Alger, c’est-à-dire là où l’État colonial organise l’administration de l’Algérie et produit une propagande destinée à présenter sous un jour favorable l’action de la France en Algérie. Ainsi, un des rapports de la France à l’ONU sur le problème algérien sera surnommé « le Bourdieu ». Il s’agit d’un énorme travail documentaire sur l’Algérie destiné à mettre en évidence les progrès réalisés tant au plan institutionnel, économique, éducatif, social et financier, et répondant point par point aux critiques du Front de libération nationale (FLN). À l’origine, la position du jeune Bourdieu dont la marge de manœuvre en tant qu’appelé du contingent était aussi particulièrement réduite semble avoir été « ambivalente ». Il était du moins particulièrement sensible à « la complexité du problème algérien », même si ses travaux ultérieurs n’alimenteront pas la veine de l’Algérie française.
En 1958, son premier ouvrage, Sociologie de l’Algérie, publié aux Presses universitaires de France dans la collection « Que-sais-je ? », propose un premier bilan critique de ce qu’il a accumulé par ses lectures et ses observations. Son objectif est de dire aux Français – surtout à ceux de gauche – ce qu’il en va vraiment d’un pays dont ils ignorent souvent à peu près tout. Et par là aussi « de conjurer ce sentiment d’être le témoin impuissant d’une guerre atroce ». Ce travail plus ou moins saugrenu pour un philosophe de formation est favorablement accueilli, même si certains lecteurs estiment cette publication trop précoce et soulignent l’absence d’expérience prolongée des réalités algériennes de son auteur. De fait, il est encore très livresque mais atteste de la familiarisation progressive de P. Bourdieu avec la sociologie et l’ethnologie qui ne se résument alors plus pour lui à « des PQ ». Mais il pense cette publication comme une simple parenthèse car une fois achevé ce « travail de pédagogie politique », il compte revenir à la philosophie.
La conversion aux sciences sociales ne semble s’opérer qu’au moment où, libéré de ses obligations militaires, P. Bourdieu décide de rester en Algérie pour enseigner à l’université d’Alger plutôt que dans un lycée toulousain. C’est alors qu’il opère un véritable « tournant empirique » rompant avec ses dispositions philosophiques en lançant ses premières enquêtes collectives sur l’Algérie et en manifestant pour la première fois un véritable habitus « de patron ». C’est donc en quasi-autodidacte, de surcroît dans un contexte de guerre, qu’il fait l’apprentissage des différentes techniques d’enquête.
Mais, comme le note Victor Collard, ce glissement progressif de la philosophie à l’ethnologie, puis à la sociologie, s’opère dans un contexte de renaissance des sciences sociales en France avec par exemple la création en 1958 de la licence de sociologie, la multiplication des financements pour la recherche, la croissance du nombre de chercheurs au CNRS, etc. À cela s’ajoute le prestige conquis récemment par l’anthropologie grâce à l’œuvre et à la figure de Claude Lévi-Strauss, la montée des sciences sociales et du structuralisme menaçant l’hégémonie traditionnelle de la philosophie. Enfin concernant P. Bourdieu, il faut ajouter la guerre comme « facteur de perturbation biographique » et son insatisfaction vis-à-vis du « jeu philosophique » fut-ce dans sa forme la plus sévère et rigoureuse. Pour lui, ce passage à la sociologie (via l’ethnologie) est aussi l’occasion de renouer avec des dispositions sociales plus ou moins refoulées par l’univers scolastique, comme de se réconcilier avec des expériences d’enfant.
Fin 1959, p. Bourdieu rentre à Paris parce qu’il fait partie de la liste rouge, soit des individus surveillés par les partisans de l’Algérie française et pour des raisons d’opportunités académiques. En effet, Raymond Aron qui a repéré son « Que sais-je ? » sur l’Algérie le nomme assistant à la Sorbonne en 1960, puis en fait le secrétaire général et directeur adjoint du Centre de sociologie européenne. Manifestement, R. Aron éprouve une certaine fascination pour ce « normalien surdoué » qui lui paraît être le seul aspirant sociologue à même « d’injecter dans le quotidien de ses recherches empiriques la profondeur de la réflexion philosophique » et par là susceptible d’incarner une forme « d’excellence sociologique à la française ».
En 1961, P. Bourdieu est nommé maître de conférences à l’université de Lille où il s’investit à nouveau pleinement dans ses activités d’enseignement et R. Aron lui dira un jour qu’il est le premier assistant à s’intéresser aux étudiants. Il enrôle nombre d’entre eux dans ses enquêtes et certains deviendront sociologues. Parallèlement, il poursuit ses recherches sur l’Algérie et le Béarn.
Pour décrire le passage de p. Bourdieu de la philosophie à la sociologie, Victor Collard mobilise l’expression particulièrement heureuse de « transfuge de champ ». En effet, sa conversion à l’empirie s’opère à la fois avec et contre sa formation philosophique initiale, ce qui le positionne de façon originale dans le champ des sciences sociales. En effet, s’il rompt avec l’illusio philosophique et la position régalienne et surplombante que cette discipline entend occuper dans l’espace des lettres et sciences humaines en se lançant par exemple avec frénésie dans des enquêtes empiriques mais rigoureusement construites, il n’en conserve pas moins des relations aves ses anciens maîtres, camarades philosophes favorables à son projet intellectuel et qui constituent alors son « collège invisible ». D’où l’ampleur de ses entreprises intellectuelles indifférentes aux frontières entre spécialités sociologiques qui le conduisent alors à dialoguer avec l’ensemble des sciences sociales, comme avec la philosophie.
Pour conclure, il faut souligner l’impressionnant travail d’archives sur lequel est fondé ce travail issu d’une thèse et donc publié par un jeune sociologue, ainsi que les difficultés de l’exercice. En effet, ardent promoteur de la réflexivité en sciences sociales, P. Bourdieu avait lui-même procédé à son auto-analyse ; les chercheurs en sciences sociales ont, pour cette raison, de grandes difficultés à s’abstraire des analyses qu’il a proposées.